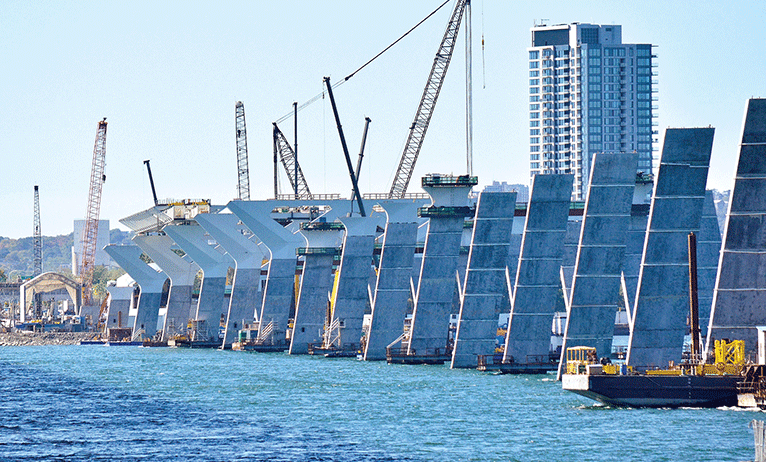Diagnostic - Accords de réparation : à quoi s'attendre ?
2019-10-04
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/accords-reparation-a-quoi-attendre
2023-10-02
Diagnostic - Accords de réparation : à quoi s'attendre ?
Finances , Gestion des risques

Article publié dans l'édition Automne 2019 de Gestion
Pour contrer l’oubli provoqué par la succession ininterrompue des nouvelles quotidiennes, Gestion décortique les enjeux qui se cachent derrière les grands titres.
La firme québécoise d’ingénierie SNC-Lavalin est accusée par le Canada d’avoir versé près de 50 millions $ CA en pots-de-vin à des représentants libyens entre 2001 et 2011 afin d’obtenir des contrats. Après qu’on lui eut refusé la suspension de la poursuite et la possibilité d’un accord de réparation en 2018, l’entreprise s’est retrouvée au cœur d’une saga politico-judiciaire qui fait encore des remous. À quoi sert ce nouveau régime, intégré au Code criminel canadien au printemps 2018 ? Et surtout, qui sert-il ? Pour répondre à ces questions, Gestion s’est entretenue avec Jennifer Quaid, professeure de droit civil à l’Université d’Ottawa.
Les accords de réparation permettent de résoudre une poursuite en évitant aux entreprises une condamnation judiciaire. Qu’évite-t-on, précisément ?
Jennifer Quaid : Du côté tant de l’accusé que du poursuivant, cela permet d’être fixé plus rapidement et plus sûrement qu’en cas de procès. De cette manière, on élimine les coûts et les délais associés au cours normal de la justice. Bien que d’ordre pratique, cette considération n’est pas à négliger, notamment en affaires : toute chose incertaine qui s’éternise nuit généralement à la rentabilité. De plus, le fait de ne pas subir de condamnation permet non seulement de protéger sa réputation mais surtout de conserver la possibilité de soumissionner pour des appels d’offres publics.
Du côté des poursuivants représentant l’intérêt public, l’avantage d’un accord de réparation consiste à obtenir de l’entreprise un certain nombre de concessions qu’on estime favorables au bien-être collectif : amende, indemnisation des victimes, collaboration contre d’autres responsables et, bien sûr, reconnaissance publique de responsabilité. Ces accords ont aussi une vocation éducative en diffusant un message dissuasif auprès d’autres acteurs du marché.
LIRE AUSSI : « Fraudes financières et dirigeants d'entreprise : les leçons à tirer »
Éviter une condamnation permet aussi d’éviter des conséquences négatives pour les employés, pour les sous-traitants et pour les retraités d’une entreprise accusée...
J. Q. : Bien sûr, le gouvernement va signaler qu’un accord permet d’éviter des conséquences dommageables pour des tierces parties, mais cet élément est souvent l’objet de confusion. En cherchant à conclure un accord de réparation, l’État reconnaît qu’il est préférable de négocier la réhabilitation d’une entreprise plutôt que de l’écraser avec des sanctions lourdes.
Autrement dit, l’État estime que le fait d’amener une entreprise vers des pratiques conformes au droit plutôt que de s’en débarrasser correspond à l’intérêt du bien commun. Mais ce n’est pas le sauvetage de tierces parties qui dicte cette conduite. Selon le régime de droits, les critères retenus pour déterminer l’intérêt public portent avant tout sur la capacité d’une entreprise à être réhabilitée. Si on ne la croit pas susceptible de corriger ses pratiques et de se conformer aux règles, le nombre d’emplois qui seront perdus importe peu.
Le Canada vient tout juste d’adopter son régime alors que ces accords se négocient partout ailleurs. Leurs effets diffèrent-ils d’un pays à l’autre ?
J. Q. : Une des raisons pour lesquelles le Canada a décidé d’intégrer un régime d’accords de réparation à son Code criminel, c’est précisément parce que plusieurs autres pays commencent à se doter d’instruments semblables. Les « accords de poursuites suspendues » sont utilisés régulièrement depuis le début des années 1990 aux États-Unis et se multiplient dans le monde depuis cinq ans, notamment en Europe. En inscrivant ce régime dans sa loi, le Canada tente de mettre les entreprises canadiennes et celles qui sont actives sur son territoire sur le même pied que la concurrence étrangère.
Cela dit, les différences peuvent être considérables d'un pays à un autre. Le Canada fait partie d’un club assez sélect de pays – notamment les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie – qui assujettissent les entreprises au droit pénal. C’est moins courant sur le Vieux Continent, où les accords conclus impliquent des sanctions administratives plutôt que criminelles. Les risques d’atteinte à la réputation liés à une condamnation ne sont donc pas les mêmes partout. Sur le plan économique, cela dit, l’effet de ces sanctions sur les entreprises est comparable parce qu’elles prévoient toutes de bloquer l’accès aux soumissions dans les appels d’offres publics. Or, c’est ce que toute entreprise dans le monde veut éviter à tout prix.
Les amendes imposées lors de ces accords sont-elles susceptibles de corriger les comportements ?
J. Q. : L’argent n’est pas un outil de changement rapide au sein d’une entreprise. Si on ne s’attaque pas aux mesures de contrôle, de vérification et de surveillance, notamment pour ceux qui peuvent faire des dépenses discrétionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, les problèmes vont se reproduire. Un élément a tout particulièrement attiré mon attention. Le nouveau régime canadien prévoit deux types de mesures de réparation à inclure dans un accord : certaines obligatoires, d’autres facultatives.
Comme par hasard, les mesures « correctives » d’une culture d’entreprise ne sont pas obligatoires, contrairement au paiement d’une amende, au dédommagement des victimes ou à la coopération avec les autorités. Or, je crois fermement que les gens qui travaillent au sein d’une entreprise se comportent en fonction des valeurs et de la culture de l’organisation. Cela a un effet d’encouragement qui peut freiner la survenance des infractions. Là, à mon avis, se trouve l’intérêt public.
Le régime canadien d’accords de réparation passe-t-il à côté de sa mission d’intérêt public ?
J. Q. : Ces accords ne sont pas une panacée, mais ils ont leur utilité. Ils ont malheureusement été mal expliqués et le public entretient des attentes complètement déraisonnables en ce qui a trait à leurs retombées. Cela dit, nous n’en sommes qu’au début. Il va falloir attendre la mise en application du régime pour pouvoir l’évaluer à sa juste valeur.
Finances , Gestion des risques