Refondation de la santé : éloge de l’économie
2022-04-06
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/refondation-de-la-sante-eloge-de-leconomie
2023-10-02
Refondation de la santé : éloge de l’économie
Management , Ressources humaines , Santé
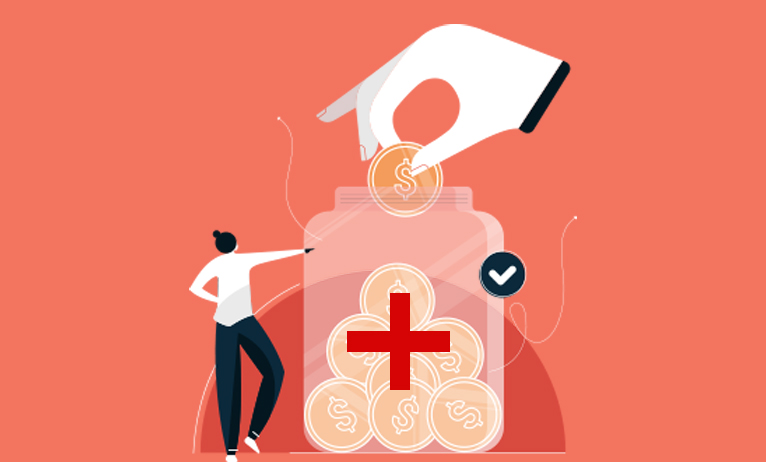
Article publié dans l'édition Printemps 2022 de Gestion
Les ratés du réseau québécois de la santé – notamment les problèmes d’attraction et de rétention du personnel, la capacité d’accueil hospitalière, les carences des outils d’information et le dysfonctionnement des structures administratives – ont poussé le gouvernement du Québec à promettre un plan de refondation du système de santé.

Alain Dubuc est professeur associé à HEC Montréal.
On doit saluer cette initiative. Mais pour que l’exercice soit fructueux, il faudra éviter qu’il se fasse en vase clos, au sein du réseau, entre artisans de la santé seulement, qu’ils soient médecins, professionnels ou gestionnaires. Le monde de la santé, paralysé par ses corporatismes, prisonnier de sa logique hospitalière, dominé par la pensée médicale, n’a pas démontré, dans le passé, sa capacité d’innover et de se réinventer.
Il sera important de faire appel à des regards extérieurs qui permettront de penser en dehors de la boîte. À cet égard, la contribution du monde de l’économie et de la gestion pourra être utile et même essentielle.
On a pu voir les bienfaits de cet apport extérieur lorsque Christian Dubé, comptable de formation, gestionnaire et ex-vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, est devenu ministre de la Santé et des Services sociaux. Son arrivée, après une succession de médecins-ministres, a été un vent de fraîcheur. Elle nous a rappelé que la discipline médicale, malgré toute sa richesse, prédispose davantage à la pensée clinique qu’à l’approche stratégique.
On notera que les spécialistes de l’économie et de la gestion sont très présents dans les débats sur la santé, qu’on pense aux contributions du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et de l’Institut de recherche en politiques publiques, ou encore, à celles de HEC Montréal, du Pôle Santé, de la Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels ou de l’Institut du Québec. N’oublions pas non plus que la Commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, est économiste de formation et que ses premiers rapports font preuve d’un humanisme et d’un sens de la nuance qui ne correspondent pas aux stéréotypes liés à la logique économique.
On peut aller plus loin
Une plus grande contribution de la logique économique, qui repose sur la recherche d’une allocation optimale des ressources, n’aurait pas mené à certaines des décisions qui ont marqué la gestion du réseau de la santé, comme le virage ambulatoire compromis par des compressions, les politiques encourageant le départ de médecins et d’infirmières, l’application mécanique de la méthode Toyota, sans compter les ravages du règne du ministre Gaétan Barrette.
Il est vrai que les dépenses de santé croissent à un rythme élevé, ce qui constitue un défi pour les années à venir. Cependant, il est important de souligner que, pour ses dépenses de santé, le Québec ne se distingue pas vraiment du reste du Canada. Mesurées en dépenses par habitant, elles sont comparables à celles des deux autres grandes provinces, l’Ontario et la Colombie-Britannique. Mesurées en pourcentage du PIB, elles se comparent à celles des provinces plus pauvres.
Les données dont on dispose ne permettent pas d’affirmer que le Québec dépense trop en santé, ou pas assez. Le problème, c’est plutôt qu’il dépense mal. En voici quelques exemples dont les conséquences ont été mises en relief pendant la pandémie.
De façon générale, le Québec a peu investi dans des outils stratégiques qui lui auraient permis de réduire les coûts et, surtout, d’améliorer les services aux citoyens. C’est le cas de ses retards en technologies de l’information et des communications, qu’on pense à l’usage désuet du télécopieur et à la découverte tardive des vertus des consultations téléphoniques pour les médecins. Le réseau de la santé a par ailleurs accumulé des retards troublants dans le développement d’outils statistiques, de mesures, de données probantes, ce qui le force trop souvent à fonctionner à l’aveugle.
Des pratiques qui semblent dénoter, comme on l’a vu dans d’autres dossiers qui ont fait surface lors de la pandémie, de puissants réflexes de résistance à l’innovation.
On note aussi une tendance à négliger des postes de dépense moins visibles, notamment en sacrifiant systématiquement les interventions en amont, qui sont en général moins coûteuses parce qu’elles préviennent les problèmes. C’est le cas du sous-investissement en santé publique, ou encore, du déséquilibre dans le soutien à l’autonomie, où l’accent est mis sur l’institutionnalisation, en RPA ou en CHSLD, au détriment de l’approche plus légère et plus humaine du maintien à domicile.
La contribution économique pourrait également mettre en valeur certaines attitudes et pratiques qui ont montré leur utilité dans d’autres sphères de l’activité humaine, et qui pourraient être introduites avec profit dans le monde de la santé.
C’est le cas de la concurrence et de l’émulation, qui stimulent l’innovation et encouragent le dépassement de soi. Cela existe dans le secteur de l’éducation, particulièrement dans le milieu universitaire, mais pas dans celui de la santé. Ou le cas de l’approche client, qui n’est pas naturelle en santé, puisque les besoins sont si grands que les intervenants du réseau n’ont pas d’efforts à faire pour remplir leurs lits ou leurs salles d’attente. L’idée de confier un rôle plus important à l’économie dans une réflexion sur la santé pourra susciter des résistances. Celles-ci tiennent en partie à cette particularité de la langue française qui fait en sorte que, au singulier, le mot économie décrit une organisation sociale ou une discipline scientifique et, au pluriel, des pratiques d’épargne. Comme vous l’aurez compris, le titre de cette chronique fait l’éloge de l’économie, pas celui des économies!
Management , Ressources humaines , Santé

