Pas bien sage, l'image!
2016-06-01
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/pas-bien-sage-l-image
2018-08-07
Pas bien sage, l'image!

Point de vue publié dans l'édition été 2016 de Gestion
S’il est un dicton qui, au fil du temps, s’est totalement éloigné de son sens premier, c’est bien cet adage célèbre qui prétend que rien n’est plus sage qu’une image. Et on devine bien pourquoi.
De nos jours, l’image occupe une place considérable dans la vie et les mœurs des sociétés. Déraisonnable, diront certains. En effet, rien ne nous indique que ce phénomène va s’atténuer ou s’inverser à l’époque « égosystémique » que nous traversons.
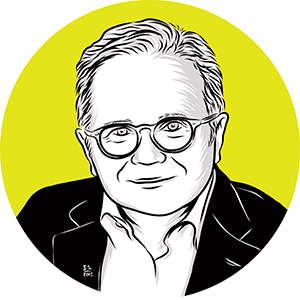
Jean-Jacques Stréliski est l’ancien vice-président et directeur général associé de Publicis Montréal ainsi que cofondateur de Cossette Montréal. Il est aussi professeur associé au Département de marketing de HEC Montréal.
Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’une quelconque toxicité ou, à tout le moins, d’un parasitage des formes objectives d’expression ? Ou alors sommes-nous en présence d’un effet de mode, d’un courant moins inoffensif qu’on pourrait le penser ? Il semble que la représentation mentale que nous nous faisons des gestes que nous voulons accomplir s’impose à nous bien davantage que nos activités réelles. Autrement dit, le regard d’autrui – ou l’idée que nous nous en faisons – conditionnerait dès l’origine la réalisation même de nos actions, l’influencerait, la mettrait en scène, en quelque sorte, en chargeant ces mêmes actions d’un artifice ou d’un détournement du sens dont elles devraient naturellement et spontanément être pourvues.
Sur une base individuelle, cette interprétation dystrophiée de sa propre image peut-elle s’assimiler à un « mensonge du soi » ? D’autant qu’au fil des jours et des semaines émerge le risque d’un passage menant du « mensonge du soi » à la « virtualisation du soi »… Serons-nous demain les avatars de nous-mêmes ? Il y a de quoi en perdre la raison !
Au cours des quarante dernières années, j’ai passé une bonne partie de mon temps à me passionner pour tout ce qui touche la fabrication, la gestion, l’évolution et l’analyse de ces images qui foisonnent dans nos univers de marketing et de médiatisation extrêmes, toutes saveurs confondues.
La rédaction de cette chronique m’aura nostalgiquement ramené loin en arrière, au temps de mes études, pour me référer une fois encore à cet incontournable essai de Roland Barthes (1964) sur la « rhétorique de l’image1». La Bible, en quelque sorte, pour celles et ceux qui, comme moi, se destinaient aux carrières de l’image, de la photographie, du journalisme, du cinéma, de la télévision et… de la publicité.
Car c’est précisément en se livrant à l’analyse sémiologique d’une simple annonce publicitaire photographique des pâtes alimentaires Panzani que Barthes nous révèle non seulement combien cette image renferme de signaux (porteurs de sens) mais également la façon dont elle évoque le récit que nous nous en faisons. Voici la description visuelle de l’annonce : un filet à provisions laissant déborder deux paquets de spaghettis Panzani, une petite boîte de sauce tomate Panzani, un sachet de parmesan Panzani, quelques tomates, un oignon, un poivron. Des champignons, une noix de muscade, des teintes de rouge, de jaune et de vert sur un fond rouge. Avec pour toute mention : « pâtes – sauce – parmesan – à l’italienne de luxe ».
Rien de plus commun, comme vous voyez. Rien de plus complexe, en vérité. Une image empathique, conclut Barthes, finement construite de signaux clairs.
Cette image, on l’aura compris, sera pour lui le prétexte à en disséquer chaque signe, chaque symbole, et à se soumettre à une rigoureuse démonstration de la théorie qu’il ébauche.
Nous comprenons également que l’étymologie même du mot « image » nous conduit à en anticiper le sens premier. Imitari serait la racine latine de ce mot. Ici, Barthes met l’accent sur la représentation analogique, la « copie » de cette image – non imaginée par nous mais pour nous. Et sur la force de son impact, qui s’intensifie en fonction de notre propre traitement narratif inconscient. L’image est, en premier lieu, une représentation mentale.
« Écoutez ma photo, elle parle ! »
En 2016, les choses ont bien changé. Les publicitaires et autres « faiseurs » d’images ont constaté depuis lors que ces représentations se suffisent quasiment à elles-mêmes. Et sans intermédiaires. Menaçant, du même coup, leur rôle d’influenceur ou de gestionnaire. Chacun saisissant qu’il est relativement « facile » de gérer sa propre image si on en prend soin, si on respecte quelques règles fondamentales et si on utilise quelques moyens dynamiques. C’est-à-dire les supports et les médias de l’heure. L’image numérique et les médias sociaux, pour ne pas les nommer. Passés maîtres dans l’usage de Twitter et de Facebook, nombre de politiciens ne se contentent plus du verbe pour communiquer : ils y joignent aussi l’image – parfois de façon exagérée, diront certains. Leur propre image. L’égoportrait (communément appelé selfie) devient l’outil idéal pour créer une image plus « parlante » d’eux-mêmes. Une stratégie qui, lorsque maîtrisée, se révèle d’une efficacité redoutable.
Nous pensons tous à Justin Trudeau, notre jeune premier ministre, qui ne craint pas de se montrer, en toutes circonstances, avec son épouse, sa famille, ou en présence des citoyens canadiens qu’il rencontre dans diverses circonstances. Nous pensons aussi au maire de Montréal, Denis Coderre, qui, sur des bases similaires, montre son engouement pour le baseball et pour le hockey avec les Canadiens de Montréal ou proclame sans réserve son intérêt marqué pour les multiples activités dans sa cité. Ils n’ont désormais plus besoin de relais : ils réussissent eux-mêmes, malgré les critiques avec lesquelles ils sont aux prises, non seulement à rompre avec les styles fermés et ambigus de leurs prédécesseurs mais aussi, à l’inverse et à l’évidence, à montrer une ouverture et une accessibilité peu communes. Des images bien plus conformes aux attentes et au langage des nouvelles générations.
Parle-t-on ici de forme ou de fond ? Un peu des deux, sans doute. Ces deux élus donnent d’eux-mêmes une image parlante qui permet à chacun des citoyens de se faire un récit à partir de l’égoportrait qu’ils diffusent. L’effet de la « spontanéité » avec laquelle cette photographie a été prise redouble l’impact de ce type d’image. On a le sentiment de partager intimement l’instant vécu. Sans artifice. Sans la distance et le protocole normalement exigés dans une relation de ce type avec cette catégorie d’élus à des fonctions parmi les plus élevées de la société civile. Sans fabrication apparente. Un message à portée et à géométrie variables. Un exhibitionnisme politiquement correct. Qui relève, bien entendu, d’une stratégie élaborée par le sujet lui-même.
De la théorie à la pratique. Mais de ce passage dans le temps, de la métamorphose consciente et inconsciente de l’image, de la surreprésentation de ses objets ou de ses sujets, que retenons-nous vraiment, sinon que se crée entre l’image et nous une accoutumance individuelle et collective, pour ne pas dire une dépendance formelle ?
Tendance et mimétisme font le reste. « Je ne suis pas ce que tu vois, je suis ce que tu te racontes à propos de mon image. »
Au fond, Barthes avait raison. D’une simple annonce de pâtes et de sauce tomate à l’expression la plus complexe de nos représentations personnelles, nous suivons des démarches similaires en cherchant à stimuler chez autrui une capacité narrative et complice, sciemment destinée à amplifier le sens de ce récit. Que nous soyons ou non politiciens !
Notes
1. Roland Barthes, Rhétorique de l’image, Paris, Éditions du Seuil, collection « Communications », 1964, p. 40.

