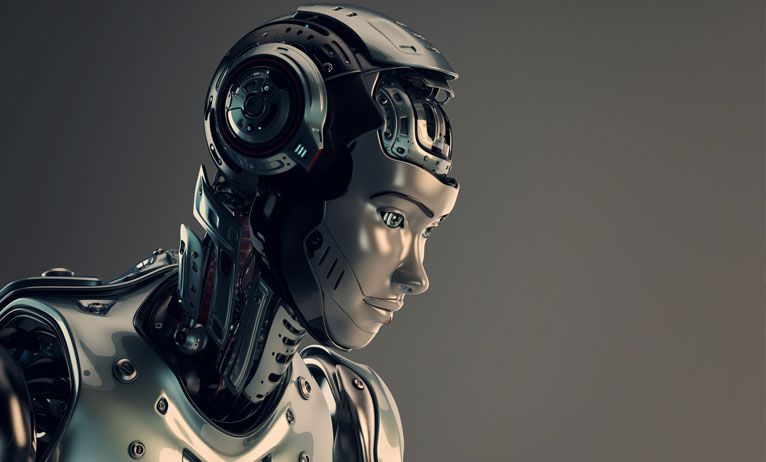Les robots sauront-ils répartir leurs bénéfices?
2016-12-19
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/les-robots-sauront-ils-repartir-leurs-benefices
2023-10-02
Les robots sauront-ils répartir leurs bénéfices?
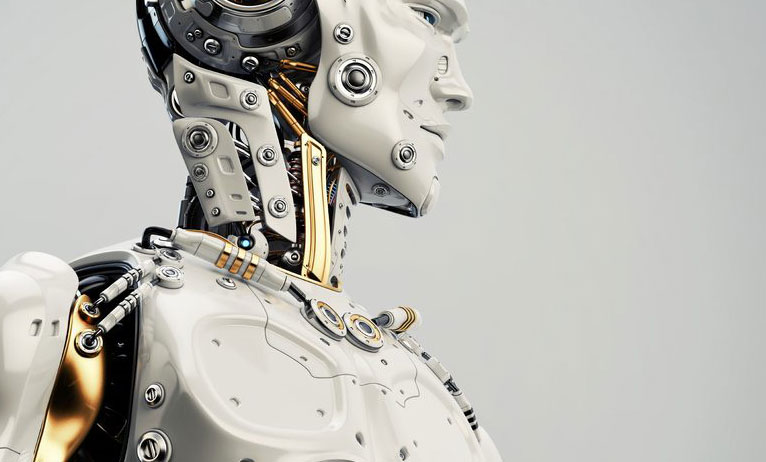
L'inévitable obsolescence programmée de l'humain…
Il est de bon ton, ces jours-ci, de prédire la fin prochaine du travail. En 2007, Timothy Ferriss écrivait The Four Hour Work Week, et avait déjà fait du « non-travail » une sorte de cible à atteindre. Entre automatisation et simplicité volontaire, il décrivait son existence post-travail : une vie passée à écrire des blogues sur les plages de Thaïlande et à s'en satisfaire pleinement. On y trouvait déjà, entre les lignes, une sorte de mépris du travail, une réduction de celui-ci à un rapport salarial désincarné, avilissant, aliénant. À la limite, un mal nécessaire.
Le réalisateur allemand Werner Herzog a récemment choisi d'explorer ces questions d'un œil plus circonspect. Le documentaire Lo & Behold : Reveries of the Connected World part à la rencontre de ceux et de celles qui fabriquent le futur et ses machines intelligentes. Il y rencontre notamment Joydeep Biswas, un inventeur américain qui assemble des robots qui jouent… au football. « D'ici 2050, nous souhaitons avoir une équipe de robots-footballeurs capables de battre les champions du monde de la FIFA », explique ce dernier. Lorsque Herzog lui demande s'il aime (d'amour?) le robot, Biswas lui répond que oui : « Nous l'aimons. Nous aimons Robot8 » (!).
Cela dit, par-delà l'aspect inédit d'un match entre le FC Barcelone et quelques robots, quel intérêt y a-t-il à regarder un tel affrontement? Et si les robots gagnent — ce qui semble inévitable, à terme —, cela signerait-il la fin du football professionnel? Cela semble peu probable. Il y a quelques années, la victoire définitive de Deep Blue — l'ordinateur d'IBM — contre le champion mondial Kasparov, n'a aucunement tempéré l'engouement pour les échecs. Au contraire, cette partie d'anthologie a incité davantage d'humains à s'atteler à la tâche ardue de maitriser l'échiquier.
En fait, derrière cette fin du travail se cache l'idée très forte que l'humain en tant qu'humain est inutile à l'économie puisqu'il se résume à une quantité finie de travail : une productivité, une capacité, une compétence, remplaçable en mieux par un automate. Ce qui est mieux est ici forcément grand, industrialisé et normalisé. Mais n'y a-t-il pas, dans le sport, comme dans le vin, l'art ou l'industrie, une valeur inhérente au travail humain? À son imperfection et à sa variabilité?
Sachant cette performance supérieure de la machine, nous sommes donc inévitablement engagés sur la voie de l'obsolescence humaine programmée. L'intérêt de cette démarche étrangement « progressiste » tendrait donc à donner raison à Staline, qui se plaisait à affirmer que « sans hommes, il n'y a pas de problèmes »!
Puisqu'il faut bien payer
Ainsi, l'humain disparaitra de l'économie sous l'empire des machines productives. Dans un article de 2014 publié dans The Atlantic, le journaliste Derek Thompson formule l'hypothèse selon laquelle la moitié des emplois seront automatisés d'ici une décennie ou deux. Par-delà l'aspect frivole d'une telle prédiction, elle permet de remettre en question les implications macroéconomiques de cette transformation et de lavènement (apparemment inévitable) de ce nouvel ordre mondial.
D'emblée, la production automatisée pose la question de la propriété des robots : si toute la production est orchestrée par des automates, qui sont ceux et celles qui possèdent ceux-ci? Et s'ils créent de la valeur, comment celle-ci est-elle (re)distribuée? Il y a fort à parier que, dans un régime capitalistique, la diminution du nombre dacteurs entrainera une concentration croissante de la richesse, ce qui pose nombre des questions éminemment politiques devant lesquelles les élites contemporaines sont très mal outillées.
En effet, la détention des automates implique forcément son lot de responsabilités sur le plan social, légal et économique. Ce sont des considérations qui jusquici ne se sont présentées que de façon marginale puisque lautomatisation a, dans une large mesure, été remplacée par la création de nouveaux secteurs économiques capables dintégrer lhumain comme facteur de production. L'économie de la connaissance, puis de la créativité, en sont les principales formes, et ont permis à un nombre croissant d'individus de se faire les détenteurs des moyens de production.
Les détenteurs des robots, les détenteurs du monde
Or dans cet avenir robotisé, la question fondamentale de la détention des actifs productifs redevient centrale à la dynamique économique. Dans un article fascinant publié dans Harvard Magazine en mai 2016 et intitulé « Who owns the robots rules the world », l'économiste Richard Freeman s'interroge précisément sur ces questions. Il rappelle la phrase célèbre du président américain Roosevelt qui déclarait que « l'inventivité des hommes détruit les emplois plus vite qu'elle ne les invente »!
Ce que montre bien Freeman, c'est que l'enjeu de la robotisation est bien davantage lié à la propriété des entreprises et à la redistribution de la valeur qu'à la simple question de l'emploi. Bien que le projet n'ait rien de nouveau, l'idée d'une répartition plus grande de la propriété des entreprises menant, par exemple, au socialisme libéral et autres formes d'entreprises autogérées, revient au goût du jour.
À ce titre, le grossiste américain Publix Super Markets est l'une des plus grandes sociétés autogérées au monde. Avec près de 185 000 salariés, l'entreprise est détenue par ses employés à 100 % depuis sa fondation en 1974. Elle a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus en 2015.
Dans le même ordre d'idées, la société de mobilier de bureau Herman Miller a institué en 1983 un programme avantageux de participation à l'actionnariat. Plus de 16 % de l'entreprise est détenue par ses collaborateurs, soit environ 300 millions de dollars.
Ces nouvelles formes ont l'avantage de faire reposer l'adoption des technologies et leur déploiement productif sur les épaules partagées d'un plus grand nombre d'acteurs. Pendant sa candidature à l'élection présidentielle, la candidate Hillary Clinton a même fait miroiter la possibilité d'avantages fiscaux pour ce type de structure de gouvernance. Mais Clinton n'a pas été élue.
Ainsi, bien qu'il semble inévitable que l'État intervienne tôt ou tard pour favoriser une transition vers de nouveaux modèles économiques, les questions liées à la propriété des robots, et au partage des bénéfices collectifs que nous en tirerons, reste pleine et entière. Elle nous interpelle tous, et nous engage dans une nouvelle forme de réflexion sur la nature de la rémunération du travail et du capital. Bien que le travail reste un concept élusif à l'ère des robots, il semble probable, du moins à court terme, que l'apport des humains sera encore nécessaire, ne serait-ce que pour concevoir les automates qui demain viendront les remplacer. Il reste à décider qui, de nous ou d'eux, saura le mieux répartir cette nouvelle source de richesse.