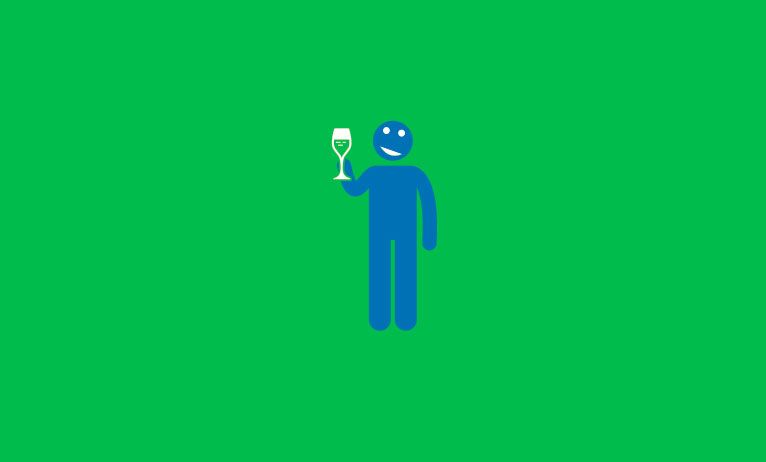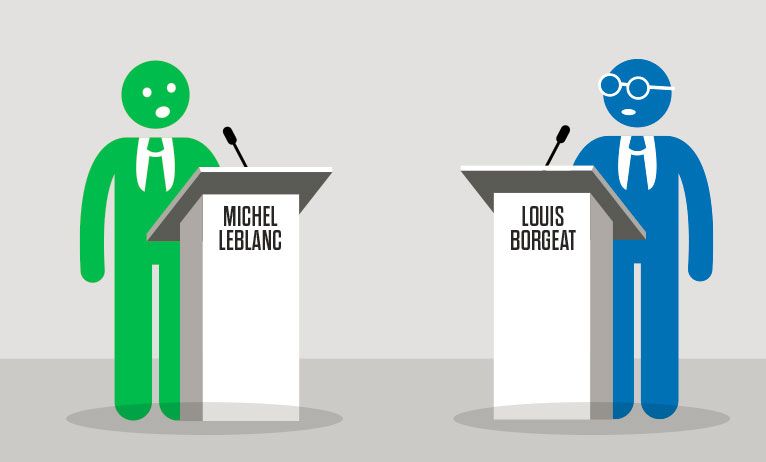DOSSIER L'État est-il bien géré? - SAQ : commerce de détail, propriété d'État
2017-12-18
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/dossier-l-etat-est-il-bien-gere-saq-commerce-de-detail-propriete-d-etat
2023-10-02
DOSSIER L'État est-il bien géré? - SAQ : commerce de détail, propriété d'État
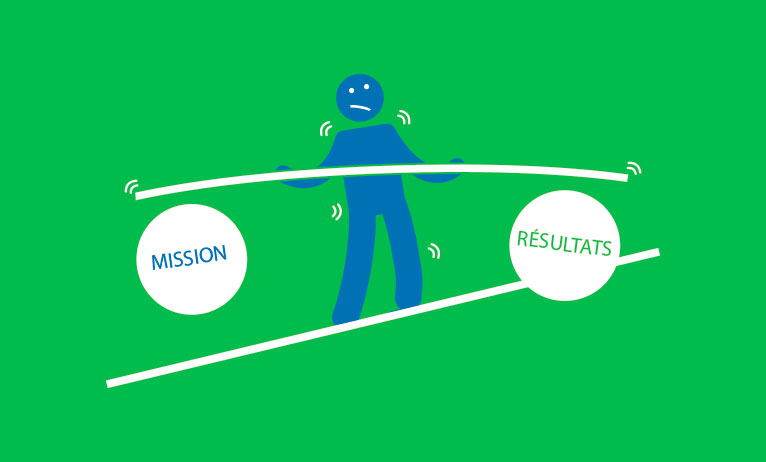
La Société des alcools du Québec ne laisse personne indifférent. Certains célèbrent sa contribution aux finances de l’État et son rôle de promoteur d’une consommation responsable d’alcool. D’autres réclament à grands cris la fin de son monopole et sa privatisation. Dans un tel contexte, sa gestion n’est pas toujours simple.
|
À lire également : |
« Nous sommes une société d’État à vocation commerciale dotée d’une grande indépendance de gestion, lance Alain Brunet, président de la Société des alcools du Québec (SAQ). Nous avons le même objectif qu’un commerce de détail privé, soit créer de la valeur. La différence, c’est que nous créons de la richesse pour tous les citoyens québécois, plutôt que pour quelques actionnaires. »
Alain Brunet ajoute que la SAQ vend un produit pas tout à fait comme les autres. En effet, la consommation d’alcool a des répercussions sur la santé publique. La SAQ a donc aussi une mission d’éducation en matière de consommation responsable. « Cela nous impose d’atteindre un équilibre, dit le président. Nous ne pouvons pas maximiser la commercialisation au point de favoriser une surconsommation d’alcool. »
Pour Russell Fralich, professeur invité à HEC Montréal, cela illustre bien une des complexités qu’une société d’État doit affronter. « Lorsque des problèmes apparaissent dans la gestion d’une société d’État commerciale, cela provient souvent de contradictions inhérentes à sa mission, explique-t-il. Par exemple, pourquoi la SAQ existe-t-elle ? Pour modérer le niveau de consommation d’alcool ? Pour servir de vache à lait à l’État ? Pour répondre à un besoin commercial en offrant une grande variété de vins et spiritueux ? Si c’est tout cela à la fois, cela ne facilitera pas la gestion. »
Une gestion plus serrée
Résultats des récentes transformations, le nombre de bouteilles vendues à la SAQ a grimpé significativement pendant la première moitié de 2017.
Alain Brunet est d’avis que la SAQ a grandement raffiné sa gestion depuis le milieu des années 1980. Au cours de cette période, la société d’État a beaucoup travaillé son expertise en matière de produits, notamment en formant mieux son personnel. À la fin des années 1990, l’arrivée à la tête de la SAQ de Gaétan Frigon, un spécialiste du commerce de détail, a permis d’élaborer des outils et des stratégies de gestion vraiment liées à ses besoins de détaillant et d’accélérer le virage vers la commercialisation. Les années 2000 ont plutôt été celles de l’amélioration de la gouvernance, dans la foulée de l’adoption de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État en 2006 et de la quête de performance.
« Depuis un peu plus de cinq ans, nous avons encore accru la rigueur de notre gestion en bâtissant sur l’infrastructure mise en place par nos prédécesseurs, explique Alain Brunet. Ces années ont été bonnes du côté de la progression du dividende et des bénéfices. » De fait, la SAQ a remis en 2017 un dividende de 1,086 milliard de dollars au gouvernement du Québec. Cette année-là, en effet, les ventes avaient augmenté de 1,6 %. En tenant compte des taxes, la SAQ a versé un total de 2,13 milliards de dollars aux gouvernements québécois et canadien.
Pourtant, ces chiffres ne convainquent pas tout le monde. En 2016, le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal a publié une étude critiquant le faible gain en matière de productivité et d’efficacité à la SAQ au fil des ans. « La SAQ a un monopole et des clients captifs, c’est donc normal qu’elle rapporte de l’argent, mais ça ne dit pas si elle est efficace, avance Robert Gagné, professeur à HEC Montréal et coauteur du rapport. Pendant longtemps, le gouvernement a encaissé son dividende sans remettre en question l’efficacité de la SAQ et sans lui imposer de cibles précises dans ce domaine. Or, si elle était plus efficace, la SAQ pourrait rapporter davantage ou encore baisser ses prix. »
M. Gagné concède toutefois que la situation a changé depuis deux ans et que le gouvernement effectue un contrôle plus serré de la productivité et de l’efficacité de sa société d’État. De son côté, Alain Brunet défend le bilan de la SAQ, exemples à l’appui. Il cite d’abord la croissance des ventes de 50 % à la SAQ en dix ans, contre 37 % pour l’ensemble du commerce de détail au Québec et 30 % pour les épiceries. « Si, comme monopole, nous avions sous-performé par rapport à des commerces comparables, ce serait un problème, mais nous avons plutôt surperformé », précise-t-il.
M. Brunet rappelle aussi que le personnel administratif a été réduit de 30 % depuis un an et demi. Cela a généré des gains d’efficacité. « Non seulement parce qu’on a coupé des postes mais aussi parce que cela traduit une amélioration de nos processus de gestion, devenus plus agiles, moins lourds et plus au diapason du commerce de détail », explique le président.
Monopole et efficacité
Un monopole public est-il nécessairement moins efficace qu’une entreprise privée soumise à la concurrence ? « Dans toute organisation, il y a une tendance à l’inertie et à la résistance au changement, indique Russell Fralich. Dans le privé, lorsqu’une entreprise affronte un cycle négatif et connaît des problèmes financiers, c’est l’occasion d’un grand ménage. Les actionnaires exigent des changements, les processus sont revus, le pouvoir dans l’entreprise est redistribué, etc. Dans une société d’État monopolistique, quel est le moteur de ce changement ? »
Robert Gagné ajoute que le monopole de la SAQ est artificiel et non surveillé. « Hydro-Québec doit justifier ses hausses de prix devant la Régie de l’énergie, laquelle peut les accepter ou les refuser, illustre-t-il. Ce n’est pas le cas de la SAQ. Cela n’aide pas à renforcer son efficacité, car elle peut faire ce qu’elle veut pour augmenter son dividende. Il n’y a ni concurrence ni réglementation des prix. »
Des critiques qu’Alain Brunet a souvent entendues mais qu’il trouve un peu réductrices, voire idéologiques. « Nous sommes en train de démontrer qu’un monopole n’a pas à être peu performant : ce n’est pas une fatalité, affirme le président de la SAQ. Notre ratio des charges net est passé de 25 % à 16,4 % actuellement. Nous avons aussi revu à la baisse nos marges de profit sur nos produits afin de diminuer nos prix. »
La réingénierie des processus organisationnels a payé en partie la diminution de revenus entraînée par la baisse des prix, mais elle ne suffit pas. Cependant, cela fait partie d’un plan stratégique sur trois ans visant à générer de la croissance, lequel a reçu l’aval du gouvernement. « Le bénéfice devrait croître d’environ 1 % par année au cours des trois prochaines années, même si notre volume de ventes augmente de 5 ou 6 %, prévoit Alain Brunet. Le gouvernement a donné son accord parce qu’il comprend qu’on accroît l’efficacité, qu’on devient plus performants et que cela amènera une plus-value durable. »
La transformation de la SAQ porterait déjà ses fruits. Le nombre de bouteilles vendues, qui n’avait pas augmenté de façon significative depuis trois ans, a grimpé de 8 % en six mois. Selon Alain Brunet, il ne s’agit pas seulement de l’effet de la baisse des prix mais plutôt d’une conséquence à la fois de l’optimisation des différents canaux de distribution, dit virage omnicanal, et du programme Inspire. Ce dernier permet notamment d’abandonner le marketing de masse en faveur d’offres personnalisées, beaucoup plus efficaces et souhaitées par la clientèle.
Créatrice de valeur
 Pour Jacques Nantel, professeur de marketing à HEC Montréal, le virage omnicanal et les nouvelles stratégies d’intelligence d’affaires et de marketing personnalisées illustrent bien le rôle que joue une société d’État par rapport à une entreprise privée. « L’approche de la SAQ est très novatrice pour le Québec, souligne-t-il. Or, puisque la SAQ est une société d’État, elle sert de laboratoire pour l’écosystème du commerce de détail québécois. Son expertise est transférable ; celle d’Amazon ne l’est pas. Si la SAQ était un monopole endormi sur ses lauriers, elle ne se lancerait pas dans ce genre de transformation. »
Pour Jacques Nantel, professeur de marketing à HEC Montréal, le virage omnicanal et les nouvelles stratégies d’intelligence d’affaires et de marketing personnalisées illustrent bien le rôle que joue une société d’État par rapport à une entreprise privée. « L’approche de la SAQ est très novatrice pour le Québec, souligne-t-il. Or, puisque la SAQ est une société d’État, elle sert de laboratoire pour l’écosystème du commerce de détail québécois. Son expertise est transférable ; celle d’Amazon ne l’est pas. Si la SAQ était un monopole endormi sur ses lauriers, elle ne se lancerait pas dans ce genre de transformation. »
Cela démontre, selon M. Nantel, que la SAQ crée de la valeur d’une manière différente de celle des entreprises privées, ce qu’on ne prend pas toujours en considération lorsqu’on analyse son fonctionnement. Il donne l’exemple de l’obligation, inscrite dans sa mission, d’offrir une grande variété de produits dans toutes les régions du Québec. « Vous ne trouverez pas ça chez un distributeur privé, pour un territoire aussi vaste et aussi peu densément peuplé que le Québec, souligne-t-il. En Alberta, après la privatisation du commerce de l’alcool, on a vite observé une plus grande variété dans les grands centres mais une forte baisse de l’offre à l’extérieur des grandes villes. La SAQ doit maintenir son offre partout. En tenant compte de ce type de contrainte, il faut bien admettre qu’elle demeure un réseau de distribution extrêmement efficace. »
Gestion sous surveillance
Mais la contrainte absolue reste bien sûr la très haute exigence en matière de transparence. « Une société d’État doit rendre des comptes de manière très publique et ses dirigeants prêtent toujours flanc à la critique, explique Russell Fralich. Les décisions, les salaires des dirigeants et des employés, les prix, les marges de profit, le dividende, etc. : tout est scruté de très près. Dans le privé, les actionnaires peuvent critiquer, mais pas nécessairement en public. »
C’est ce qu’Alain Brunet appelle « gérer dans un aquarium ». « Nous gérons comme des dirigeants d’entreprises privées de commerce de détail, mais nous sommes souvent jugés comme des fonctionnaires, confie-t-il. Or, il ne faut pas se laisser “figer” par cela. Il faut continuer d’avoir une culture de commerce de détail, plutôt qu’une culture de fonction publique, et mener nos projets stratégiques dans cette optique, même si nous avons, comme dirigeants, une marge d’erreur à peu près inexistante. C’est aussi ça, gérer une société d’État ! »