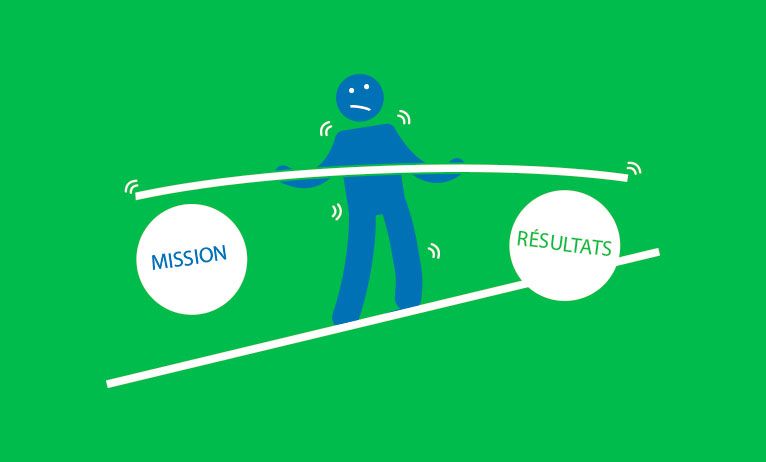DOSSIER L'État est-il bien géré - Gestion publique, gestion privée : les différences fondamentales
2017-12-17
 HEC gestion
HEC gestion
French
https://www.revuegestion.ca/dossier-l-etat-est-il-bien-gere-gestion-publique-gestion-privee-les-differences-fondamentales
2023-10-02
DOSSIER L'État est-il bien géré - Gestion publique, gestion privée : les différences fondamentales
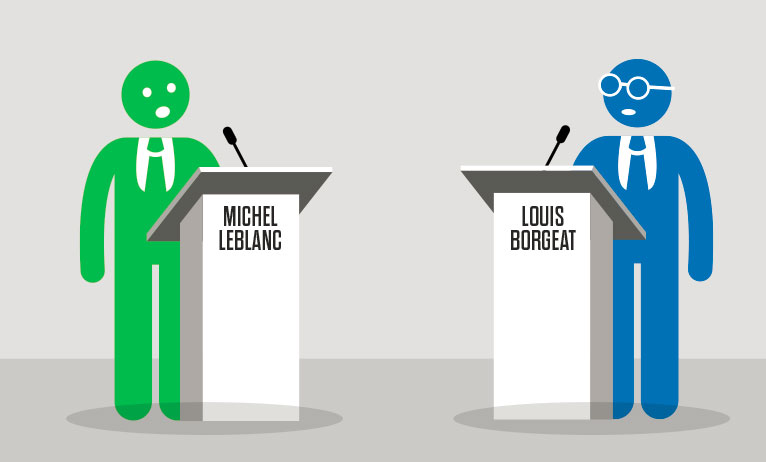
Les perceptions et les attentes en ce qui concerne la gestion en entreprise privée et dans l’appareil de l’État s’expriment souvent en termes d’opposition. Gestion a invité deux vétérans des secteurs public et privé, Louis Borgeat et Michel Leblanc, à discuter des origines de ces différences. Ils ont ainsi analysé les facteurs qui influencent les actions des gestionnaires et l’opinion que s’en font les citoyens. À maintes reprises sur ces questions, ils ont été d’accord.
Des questions de valeurs

Louis Borgeat a fait carrière au sein de l’administration publique québécoise. Ce juriste de formation a tour à tour été professeur à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) puis sous-ministre associé au ministère de la Justice, secrétaire général associé à la législation au ministère du Conseil exécutif et président de l’Office de la protection du consommateur. Il est aujourd’hui le protecteur universitaire de l’ÉNAP.
Louis Borgeat : Les valeurs qui orientent le travail sont bien différentes dans le public et dans le privé. L’État vise d’abord à servir les citoyens dans une optique d’équité, de neutralité, de transparence et d’intérêt public. Les entreprises sont plutôt mues par la nécessité d’être rentables. Elles doivent maximiser leur efficacité en plus de faire preuve d’empathie envers le client afin de mieux le comprendre et de mieux le servir.
Depuis 30 ans, le secteur public a lui aussi adopté des pratiques de gestion qui favorisent l’efficacité. Et ç’a donné des résultats positifs. Sauf que cette valeur d’efficacité vient s’ajouter aux autres, que l’État doit continuer à honorer. Ça exige donc un effort considérable, parce qu’il y a beaucoup de balises à respecter.
La population se montre sévère envers les services publics parce qu’elle les finance sans avoir le choix de faire affaire avec eux ou non. Les citoyens ont des attentes plus élevées qu’envers le secteur privé parce qu’ils sont en quelque sorte dépendants de ces institutions-là… à moins de déménager.

Michel Leblanc est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) depuis 2009. Il a consacré sa vie professionnelle à la défense des intérêts du secteur privé. Il a notamment occupé des postes de haute direction chez Secor, Génome Québec et Montréal International.
Michel Leblanc : Je pense que cette exigence n’est pas exclusive au secteur public. Je pense plutôt qu’il découle de l’apparence de manque de concurrence qui caractérise certains marchés où le client croit constater une situation monopolistique ou oligopolistique. Les banques, les transporteurs aériens et les compagnies de télécommunications, par exemple, suscitent elles aussi des questionnements.
Les attentes envers les gestionnaires sont différentes elles aussi. Au privé, le client espère obtenir un bon service mais se soucie peu du gestionnaire lui-même. Il ne cherche pas à connaître son salaire. Au public, l’usager finance les sociétés d’État et les divers ministères avec ses impôts et ses taxes. Il sent donc qu’il en est un peu propriétaire, de même qu’il croit avoir un certain pouvoir sur les gens qui y travaillent. « C’est mon gestionnaire dans mon gouvernement », pourrait-il dire. Les gens se permettent donc de juger du juste salaire à lui verser.
La relation avec les gens
L. B. : Le public accorde la priorité aux populations vulnérables, alors que le privé valorise les clients plus rentables. Au privé, les cas lourds sont laissés de côté, alors qu’une situation similaire au public fera scandale. Au privé, un « bon client » recevra un traitement préférentiel, alors que le « bon usager » du public sera traité comme tout le monde. La perspective est donc différente. Au gouvernement, on veut d’abord favoriser le bien commun et l’équité.
M. L. : Au privé, une personne insatisfaite peut demander à parler au patron. Au public, dans un hôpital par exemple, les normes et l’obligation de traiter tout le monde équitablement limitent la marge de manœuvre d’une infirmière en chef qui voudrait en faire davantage pour un patient. Pour un transporteur aérien, il est normal de traiter aux petits oignons les 10 % de clients qui font 90 % des voyages. Si on ne faisait qu’écrire une chose pareille au public, ce serait intenable.
Publicité ou propagande ?
M. L. : En mettant sur pied une campagne de marketing réussie, une entreprise peut influencer positivement la perception qu’ont les clients de la qualité de son service. Elle crée ainsi un a priori favorable qui teinte la façon dont le client interprétera ses interactions avec elle. Par exemple, grâce au marketing, j’ai déjà le sentiment qu’Apple fait de bons produits. Si mon iPhone se brise, je me dis donc que ça devait être un citron, pas que la compagnie entière est pourrie.
L. B. : Il est vrai que le privé bénéficie de la publicité. Jean Coutu, qui arrive notamment au sommet de la liste des organisations perçues par la population comme étant les mieux gérées au Québec, en est une bonne illustration. Jean Coutu offre-t-il vraiment un meilleur service ? J’en doute, mais il a réussi à faire accepter l’idée que c’est le cas. À l’inverse, quand le gouvernement fait la promotion, par exemple, de son dernier budget annuel, on dit que c’est de la propagande !
Les médias, qui sont enclins à scruter avec plus d’entêtement les entreprises publiques, deviennent alors le premier canal de communication entre l’État et le citoyen. Et ils ont rarement tendance à chercher les bonnes nouvelles. Comme les institutions gouvernementales ont plus de difficulté à sculpter leur image au moyen de la publicité, il devient alors plus difficile de créer un engagement émotionnel
Un exemple : depuis plusieurs années, je suis un adepte de Volvo. Je vais finir mes jours avec une Volvo. C’est un peu ridicule, mais je suis attaché à la marque ! Au public, un vendeur de la SAQ peut m’être plus sympathique qu’un autre, mais les possibilités de création d’attachement sont limitées.
La transparence et l’envers de la médaille
L. B. : La nécessité de gérer les institutions publiques avec transparence permet de prévenir la corruption. Mais cette médaille a deux faces. La transparence implique de tout écrire noir sur blanc en plus de devoir justifier ses choix à tout le monde et à son père ! Toutes les décisions, des plus capitales aux plus banales, des plus complexes aux plus simples, risquent de faire les manchettes et d’être soumises au jugement de M. et Mme Tout-le-monde.
Cela crée une lourdeur bureaucratique qui freine la prise de risque et ralentit l’innovation. On peut toujours innover, bien sûr ! Mais s’il veut tester une nouvelle pratique, un organisme public doit souvent mettre sur pied un projet pilote, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois, afin de mettre de côté momentanément certaines règles.
M. L. : L’autonomie et la liberté d’action données aux gestionnaires du privé, couplées à la probabilité moindre de voir leurs erreurs étalées par les médias sur la place publique, leur permet au final, je crois, d’obtenir de meilleurs résultats. Au privé, j’hésiterai moins à envoyer un employé en voyage à l’autre bout du monde pour évaluer une pratique prometteuse. Au gouvernement, ce serait automatiquement louche.
La relation à l’imputabilité des décisions est parfois malsaine dans le public. Un directeur ou un sous-ministre fautif est rarement renvoyé. À l’inverse, il arrive qu’un ministre soit accusé d’être responsable d’un problème qui a germé bien en dessous de lui. C’est le jeu politique.
Je ne dis pas que la situation est parfaite au privé, mais une entreprise peut généralement mieux identifier la personne responsable d’un problème et lui imposer une sanction proportionnée.
Des domaines d’action distincts
L. B. : Dans l’appareil de l’État, les niveaux inférieurs sont responsables des questions opérationnelles – l’application des normes –, qui sont plutôt simples à régler. Je pense par exemple à un agent qui administre le système de prêts et bourses pour les étudiants. Mais aux niveaux supérieurs, au niveau de la gouvernance de l’État, les questions sont d’une complexité digne d’un casse-tête chinois.
Tous les problèmes qui ne se règlent pas ailleurs dans la société tombent sur les bras de l’État : le cannabis, l’aide à mourir, les signes religieux. On en parle durant des années sans trouver de réponse. C’est parfois d’une complexité inouïe. Les politiciens et les administrateurs publics deviennent alors la cible des critiques d’un ensemble d’observateurs mécontents de situations impossibles à régler à la satisfaction de tout le monde. C’est sans compter qu’un peu moins de la moitié des électeurs a généralement voté contre le parti politique au pouvoir et part donc avec l’idée que le gouvernement n’a rien de bon à proposer. Le secteur privé jongle également avec des questions difficiles, mais celles-ci appartiennent à un univers mieux délimité sur le plan du savoir et sont rarement d’ordre moral.
M. L. : En affaires, mes objectifs sont assez définis : je conçois, je fabrique et je vends quelque chose. Et je peux concentrer mes efforts sur ce projet particulier. Au public, les questions sont souvent plus complexes et les décisions ont de très nombreuses ramifications, mais les gens ont malgré tout l’impression que les problèmes peuvent se régler simplement. Et les citoyens ont tout un chacun des valeurs qu’ils voudraient bien que l’État respecte. Le projet de loi sur la neutralité de l’État est un bon exemple. On s’est récemment interrogé sur l’obligation ou non d’interdire le voile islamique dans les transports en commun, parce qu’il y a une transaction au moment de monter à bord d’un autobus, le conducteur étant un représentant de l’État. Au privé, un chauffeur de taxi ou un service d’autobus se limiterait à faire payer ses clients et à les emmener à destination.
L. B. : La population est naturellement critique à l’endroit des services publics. Je pense que c’est ce qui explique que les gens aient plus de respect et de sympathie pour les grands manitous du monde des affaires que pour les fonctionnaires.